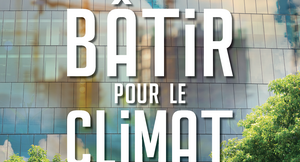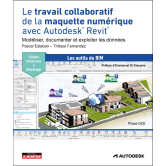« Donnons de la profondeur à la ville » David Mangin, architecte et urbaniste, cofondateur de l'agence Seura, Grand prix de l'urbanisme 2008
Aménagement -
Pour l'architecte et urbaniste, la rue est devenue ennuyeuse. Il plaide pour une conception réfléchie à l'échelle du « rez-de-ville ».
M-D.A

Que reprochez-vous à la rue telle qu'on la conçoit aujourd'hui ?
Depuis cinquante ans, nous fabriquons des quartiers ennuyeux. Le niveau du piéton - le plus important puisque tout le monde pratique la marche - est formé d'une addition de pieds d'immeubles occupés par des commerces qui fonctionnent plus ou moins bien, de logements aux volets fermés car trop exposés à la vue des passants, d'entrées de parking, auxquels viennent s'ajouter les clôtures et autres systèmes de sécurité physiques ou numériques. Le résultat est opaque et sinistre.
A quoi attribuez-vous cet échec ?
Le sujet de la rue n'est pas envisagé à la bonne échelle. Partout, dans les villes moyennes comme dans les nouvelles ZAC, la réflexion se limite à l'emprise des rez-de-chaussée et à leur occupation. Et comme nous avons en tête cet idéal type de la rue animée, une sorte de mythe hérité de l'époque médiévale, nous sommes persuadés que les rues sont majoritairement commercialisables.
Or remplir de boutiques la totalité des rez-de-chaussée est économiquement impossible. Alors, à défaut, on se tourne parfois vers des solutions qui relèvent de « l'urbanisme tactique », en installant des associations ou des activités éphémères. Cette piste sympathique et très à la mode n'est pas à la hauteur du problème. Dans la logique actuelle fondée essentiellement sur le prix de l'immobilier, elle ne fonctionne pas non plus.
Vous jugez aussi les nouveaux quartiers autocentrés. Pourquoi ?
Nous fonctionnons sur un modèle d'urbanisme périmétrique à l'extrême : on réfléchit dans les limites d'une ZAC, d'un écoquartier… Avec l'ambition de régler tous les problèmes du monde à l'intérieur de ce périmètre. Il y a un équilibre programmatique de tant d'habitants, tant de logements, tant d'activités, à respecter. A l'arrivée, on obtient un ensemble autarcique, qui ressemble à ce qui se fait ailleurs.
L'aménagement est parfois aussi basé sur les cercles d'accessibilité : cette fois, le périmètre est défini par un rayon de 400 ou 800 m autour, par exemple, des gares du Grand Paris. Cependant, tous les côtés d'une gare ne se valent pas : l'un sera effectivement vivant, doté de services et de commerces. Mais l'autre sera peut-être une zone logistique que vous ne traverseriez à pied pour rien au monde. Le dernier avatar de cette vision est cette idée en vogue de la « ville du quart-d'heure ».
Ces conceptions paraissent bienveillantes mais ne sont pas pertinentes. Si les services sont présents et le parcours confortable, les gens peuvent marcher longtemps. Donc, tout le monde se trouve confronté à ces difficultés et moi-même, je m'y heurtais dans ma pratique opérationnelle. J'ai donc voulu essayer de définir de nouveaux paradigmes, à la suite des idées que j'avais développées sur la « ville passante » (1).
Comment a été menée cette recherche ?
J'ai travaillé plusieurs années sur cette question avec les étudiants du master Métropoles dont j'assurais la direction pédagogique à l'Ecole d'architecture de la ville et des territoires Paris-Est. Des collègues à l'international ont pris la suite. Il y avait beaucoup à apprendre de l'étranger, notamment des urbanisations informelles, telles que les favelas du Brésil ou les urban villages de Shenzhen en Chine. Plusieurs voyages ont été organisés en Asie, en Afrique, en Amérique latine… En cinq ans, quelque 500 personnes ont été impliquées, et les résultats de leurs enquêtes ont été compilés en 2020.
A quoi cela a-t-il abouti ?
Je plaide aujourd'hui pour une ville des usages, vue d'en bas. Pour cela, je suggère d'envisager ce que j'appelle le « rez-de-ville » : plutôt que de restreindre la réflexion à l'occupation des pieds d'immeubles, contraints et stéréotypés, il faut prendre en compte tout le niveau du sol, avec ses rez-de-chaussée bâtis et ses espaces ouverts, publics ou privés. Voilà qui nécessite d'abord de sortir de l'urbanisme périmétrique pour penser un urbanisme d'itinéraires qui permette aux gens de satisfaire les besoins de la vie quotidienne en se déplaçant aisément à pied. Les voies sont hiérarchisées, notamment sur la base d'un repérage de ce qui préexiste, et l'on vient ensuite y caler une programmation réaliste en rez-de-ville. Les axes d'itinéraires correspondent à des flux et forment les rues animées, où l'on trouve les commerces, les services, etc. Mais il faut admettre que les rues résidentielles aux rez-de-chaussée habitables doivent être majoritaires. Les logements sont alors positionnés sur des allées tranquilles, en retrait de la voie.
« Il faut considérer le niveau du sol comme un ensemble et travailler le rapport entre espaces ouverts et fermés. »
De quoi est fait ce rez-de-ville ?
Il s'agit de le prendre comme un ensemble et de travailler le rapport entre espaces ouverts et fermés. La rue ne doit plus être considérée comme un décor de façades alignées. L'enjeu est de favoriser les usages en donnant davantage de profondeur à la ville.
Et comment l'occupe-t-on ?
Les voyages d'études nous ont permis d'observer une variété de possibilités. Ainsi, Singapour offre un exemple type d'usages : beaucoup de grands ensembles y ont été bâtis sur pilotis qui laissent le niveau du sol ouvert. Les personnes âgées viennent se retrouver là. Elles y passent la journée au frais, jouent aux dominos, cuisinent, gardent les enfants et sécurisent les lieux par leur présence.
Le rez-de-ville peut ainsi se décliner en plusieurs catégories d'espaces que j'ai classées par degrés d'épaisseur : le « passant » dans lequel on n'a pas vocation à pénétrer et qui se compose de jardins privés ou de petites échoppes ; le « poreux » où l'on entre plus avant, notamment dans des magasins plus grands ; le « profond » qui autorise à s'aventurer au cœur des parcelles, par exemple dans les cours où peuvent être installées des activités diverses. J'y ajouterais un quatrième type, dit « ouvert ». Celui-ci est transparent et continu, comme le système des bâtiments sur pilotis.
Ceci suppose un changement des mentalités. Est-ce réaliste ?
Bien sûr. Le défi est colossal. Il nécessite de changer de modèle économique, juridique ou encore de repenser la sécurité. Mais je le crois surmontable. L'expérience a montré que si les idées sont là, elles peuvent se concrétiser quand les modèles socio-économiques sont en crise.
Or les transitions environnementales et numériques sont des impératifs. Par exemple, pendant les confinements, on a vu les gens réinvestir les cours des immeubles.
Elles représentent un exemple typique de ce que le rez-de-ville peut offrir en matière de convivialité mais aussi d'implantation de bureaux, d'activités, de logements…
Quelle est la prochaine étape ?
Nous avançons en termes de représentation de nos projets urbains. Mon objectif, désormais, est de trouver des municipalités ou des aménageurs suffisamment intéressés par la notion du rez-de-ville. A Montigny-lès-Cormeilles, dans le Val-d'Oise, nous révisons le PLU et pensons les premiers projets urbains à partir de ce niveau de référence. Et à Libreville, au Gabon, nous concevons un quartier entièrement sur pilotis.
(1) « La Ville passante », éditions Parenthèses, 2008.
Baromètre de la construction
Retrouvez au même endroit tous les chiffres pour appréhender le marché de la construction d’aujourd'hui
Je découvre